
SG mag
N°1 - Janvier 2025
Les coulisses du SG
Dans les coulisses du CMVOA avec des analystes toujours en alerte
Cette année le centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte (CMVOA) fête ses 20 ans. Il est l’une des composantes du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (SHFDS) de notre secrétariat général. Créé en 2005, avec l’objectif de faire remonter les informations du terrain et d’alerter les autorités, il est aujourd’hui un outil indispensable à l’anticipation et à la réponse aux crises. À travers cinq photos, les femmes et les hommes de ce centre opérationnel nous racontent leur quotidien et les événements qui ont marqué leur mission au CMVOA.
Les yeux et les oreilles de nos ministères
Sylvain Xié, chef du CMVOA
« Les grands accidents liés à l’activité humaine et les catastrophes naturelles des années 2000 (Mont-Blanc, Erika, AZF, Canicule, SRAS…) ont poussé les autorités gouvernementales à améliorer les chaînes de remontée et de centralisation de l’information à destination des ministres. C’est dans ce contexte que le CMVOA a été créé début 2005 au sein du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer. Il était directement rattaché au service de défense et de sécurité (SDS).
Vingt ans plus tard, le SDS est devenu le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le CMVOA s’est développé. Il se réorganise en continu afin de répondre aux enjeux d’aujourd’hui : adaptation aux nouvelles typologies de crises, intégration des technologies de l’information et de la communication, formation et professionnalisation de la fonction veille.
col-sm-6

Sylvain Xié, chef du CMVOA, en salle de crise. Crédits : Terra
Au quotidien, ce qui nous motive et nous rassemble c’est le caractère très prenant du métier, et la satisfaction de créer du service public à travers l’alerte et l’aide à la décision au bénéfice des hautes autorités.
Les agents du CMVOA sont les yeux et les oreilles de nos ministères. Ils détectent, analysent et transmettent 24h/24 aux autorités les informations d’importance significative en un temps contraint. Ils sont ainsi les personnes les mieux informées de France sur les événements qui affectent le périmètre ministériel. »
col-sm-6
cimulti_colonnes

Un centre opérationnel depuis 2005
Christine Arrufat, analyste au CMVOA

Christine Arrufat, analyste, assure le suivi de l'épisode de pollution aux particules. Crédits : Terra
« Après 21 ans passées au service de l’armée de terre, j’ai rejoint le CMVOA en juillet 2005. Je me suis retrouvée au 18e étage de l’Arche de la Défense dans un bureau avec 3 autres collègues sortis de l’école nationale de techniciens de l’équipement (ENTE). Tout était à construire : les cahiers de consignes, les procédures…
col-sm-6
Dès le 16 août 2005, nous avons été prévenus du crash du vol 708 de la West Caribbean Airways au Venezuela avec 152 Français à bord. Le cœur de notre métier débutait avec la recherche d’informations. Depuis sa création, nous avons dû faire face à de nombreuses catastrophes routières, ferroviaires, aériennes, maritimes… Une fois la mission réalisée, nous nous efforçons de prendre du recul pour ne pas ramener la tristesse à la maison.
Je garde particulièrement en mémoire l’accident de bus des pèlerins polonais à Laffrey en 2007, l’accident de train de Brétigny-sur-Orge en 2013, la tempête Xynthia en février 2010, et bien-sûr l’attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Ce soir-là, l’analyste en poste au CMVOA a reçu les premiers appels de la RATP lui signalant plusieurs coups de feu dans Paris.
Vingt ans plus tard, je suis toujours au CMVOA, ma motivation reste entière et j’accomplis toujours mon métier avec passion. Mon passé de militaire y est peut-être pour quelque chose. »
col-sm-6
cimulti_colonnes


Le CMVOA aujourd’hui. Il est situé à l’hôtel de Roquelaure. Crédits : Terra
La recherche d’information au cœur du métier d’analyste
Léo Gandini, analyste au CMVOA
« Je suis arrivé au CMVOA en décembre 2023 comme contractuel. Après une période de formation de 2 mois, j’ai effectué mon premier quart au moment de la mobilisation des agriculteurs où plusieurs points de blocage avaient été identifiés.
En tant qu’analyste, notre mission est de garantir la bonne information des différentes entités qui composent nos ministères. Nous veillons sur l’ensemble des champs de compétence de nos ministères à partir de différents canaux d’information (mains courantes de la sécurité civile, de la SNCF…),
col-sm-6
et nous entretenons des relations avec l’ensemble de notre réseau déconcentré et de nos opérateurs. Nous utilisons également des outils de social listening pour suivre efficacement les réseaux sociaux. Dès lors qu’un incident grave survient, nous réalisons des points de situation. Au fil de nos points de situation, nous constatons l’accélération du rythme des crises.
En somme, être analyste au CMVOA c’est exercer une activité dynamique et ancrée dans l’actualité : on ne s’ennuie jamais ! Les journées de travail ne sont jamais les mêmes et on ne sait pas à l’avance ce qui nous attend. »
col-sm-6
cimulti_colonnes

Le Centre olympique Roquelaure
Noémie BERNARD, adjointe au chef du CMVOA
« Après 5 ans au sein du ministère de l’Intérieur, j’ai rejoint le SHFDS en mars 2024 en tant qu’adjointe au chef du CMVOA. À cette période, le sujet prioritaire était évidemment les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris, que nous préparions avec les directions générales et les opérateurs.
Les JOP de Paris 2024 ont constitué un formidable moment de cohésion et de formation autour de la préparation et de la gestion de crise pour nos ministères. Préparation, car il a fallu organiser le Centre olympique Roquelaure (COR) en lien avec l’ensemble du dispositif interministériel, en s’appuyant sur l’expertise du CMVOA pour la partie veille et alerte.
Gestion de crise, car le jour de la cérémonie d’ouverture, les sabotages sur 3 lignes à grande vitesse de la SNCF ont mobilisés le CMVOA et le COR du fait de leurs impacts très importants. Les ministres avaient besoin d’informations fiabilisées, que nous fournissions sous forme de points de situation. Cet évènement majeur le jour de la cérémonie d’ouverture nous laissait présager des Jeux mouvementés, mais au final, la préparation de l’ensemble des acteurs a permis que tout se déroule dans la sérénité. »
col-sm-6

Le Premier ministre Gabriel Attal au Centre olympique Roquelaure (COR) suite aux sabotages sur le réseau SNCF. Crédits : Terra

Pendant les Jeux, les analystes ont assuré 7j/7 et 24h/24 une veille et un suivi exceptionnels sur l'ensemble du périmètre ministériel. Crédits : Terra
col-sm-6
cimulti_colonnes

Retour sur la tempête Caetano
Commandant Guillaume GEAY, chef analyste au CMVOA

Les impacts de la tempête Caetano sur le réseau routier. Crédits : Jean-François Monnier/AFP
« Sapeur-pompier depuis 20 ans, j’ai été mis à disposition au sein du CMVOA où j’assume le poste de chef analyste. Issu du « terrain », j’ai occupé divers postes à responsabilité au sein des états-majors ou en casernes.
Le métier de chef analyste pourrait s’apparenter à celui d’un chef de salle des appels d’urgence 18/112. Il s’agit d’animer une équipe d’analystes et d’organiser le fonctionnement du centre de veille, avec un seul mot d’ordre : la continuité. La diversité des profils au sein des chefs analystes, que l’on soit sapeur-pompier, ingénieur ou gendarme, nous aide à repérer rapidement les signaux faibles, hiérarchiser les informations, créer du renseignement et au final à dégager des enjeux.
col-sm-6
La tempête Caetano de novembre 2024, à l’image des récents aléas naturels qui frappent notre territoire, s’est caractérisée par son ampleur, sa durée et son étendue géographique.
La neige, le verglas, le froid extrême impactent fortement nos infrastructures (routières, ferroviaires) mais également d’autres domaines vitaux du ressort de notre périmètre ministériel. Dans ce flux massif d’informations, notre priorité et de repérer les situations à forts enjeux et de raisonner selon le triptyque « personnes / biens / environnement ». Pendant Caetano, nos priorités se sont portées sur les naufragés de la route, les populations sinistrées et accueillies dans les centres d’hébergement d’urgence. La veille doit également se concentrer sur les coupures d’énergie et les réseaux de télécommunication, ce qui engage un processus interministériel.
Lors de cet épisode neigeux, plusieurs signaux nous ont conduits à alerter les cabinets ministériels et à leur proposer l’ouverture du centre de crise Roquelaure. Il s’agit là de notre deuxième mission : anticiper les besoins de renseignement sur le long terme, sélectionner et solliciter les acteurs des domaines impactés, organiser logistiquement la salle de crise et animer les séquences (point de situation, anticipation, décision…).
Certains agissent dans l’ombre mais tous sont animés par les mêmes motivations : servir l’État et protéger les populations. En cela, je retrouve un peu chaque jour l’esprit des soldats du feu. »
col-sm-6
cimulti_colonnes
#CommunautéSG
Suivez notre secrétariat général sur LinkedIn
Tous les jours sur LinkedIn, nous vous informons sur les dernières actualités et nous valorisons vos missions. Comme plus de 8 000 personnes aujourd’hui, suivez, partagez et commentez nos publications pour nous permettre d’accroître le rayonnement du secrétariat général et de vos actions. Rejoignez la communauté !
col-sm-6
col-sm-6
cimulti_colonnes
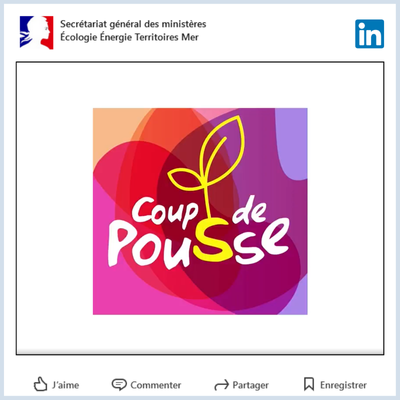
Le challenge « L’Arche pour la planète »
Ce challenge s’adresse à tous les agents du secrétariat général. Quels que soient votre grade et votre métier, nous vous invitons le temps d’une demi-journée à participer à un atelier de sensibilisation ou d’approfondissement sur un thème lié aux enjeux de la transition écologique et au changement climatique.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le portail de l’administration centrale
SG Décrypte
Une décision historique du Conseil d’État en matière de lutte contre le réchauffement climatique,
décryptage par la direction des affaires juridiques.

« Prendre part à cette avancée jurisprudentielle majeure m’a permis de contribuer à un combat essentiel : la lutte contre le dérèglement climatique. En collaborant étroitement avec nos collègues des autres bureaux de la direction des affaires juridiques et de la direction générale de l’énergie et du climat, nous avons démontré que la lutte contre le réchauffement climatique peut constituer un véritable motif d’intérêt général justifiant des décisions administratives fortes et nécessaires.
Cette décision du Conseil d’État illustre la capacité de l’administration à défendre une politique énergétique ambitieuse, en cohérence avec les engagements pris par la France dans le cadre de l’accord de Paris. C’est une victoire juridique, et surtout, une avancée concrète sur la voie de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela donne un vrai sens à notre mission au service de l’État et des générations futures . »
Agent du bureau des affaires juridiques de l’énergie

Pour la première fois, le Conseil d’État a reconnu en juillet dernier que la lutte contre le réchauffement climatique était un motif légitime pour refuser un permis de recherche d’hydrocarbures.
Une avancée à laquelle ont contribué les juristes de la direction des affaires juridiques (DAJ) qui défendent jour après jour les intérêts de l’État dans des dossiers stratégiques. Décryptage de cette décision par les équipes de la DAJ.
Dans ce contentieux, une société a sollicité une autorisation du ministère de la Transition écologique en charge des mines pour mener des opérations de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux. En juin 2017, il a été opposé un refus à cette demande. Le motif de ce refus étant justifié par l’engagement de la France, dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et, dans ce but, conformément aux objectifs fixés par le législateur, de réduire les consommations d’énergies fossiles.
La question était donc de savoir si un tel motif lié à la protection de l’environnement pouvait être légalement opposé à la demande en l’état actuel du droit. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, ont pris le parti de censurer le motif de refus.
La DAJ s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État, la plus haute juridiction de l’ordre administratif, avec pour objectif de faire valider la possibilité de refuser de délivrer une autorisation de recherche d’hydrocarbures en raison de la lutte contre le réchauffement climatique.
col-sm-6

© Conseil d’État - Flickr
Pour convaincre les juges du Conseil d’État, la DAJ a mis en avant des arguments tenant à l’interprétation des textes législatifs applicables ou encore à la reconnaissance préalable par la jurisprudence d’une obligation de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, dans le cadre de l’affaire « Grande Synthe », la juridiction administrative a rappelé à l’État ses obligations en la matière.
Dans sa décision du 24 juillet 2024, le Conseil d’État a donné gain de cause à l’État, en reconnaissant que l’administration peut rejeter la demande d’un permis de recherche d’hydrocarbures en se fondant sur l’objectif de limitation du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation des énergies fossiles.
Cette décision marque ainsi une nouvelle étape dans la prise en compte des exigences tenant à la lutte contre le réchauffement climatique par le juge administratif.
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez la lettre de la DAJ : "Angle droit"
col-sm-6
cimulti_colonnes
L’édito de Guillaume Leforestier, secrétaire général
En ce début d’année 2025, j’ai le plaisir de partager avec vous le premier numéro de SG mag, le nouvel e-magazine qui vous est dédié !
Chaque trimestre, à travers des reportages photos, des décryptages thématiques et un panorama des événements à venir, SG mag vous fera découvrir notre actualité et nos missions et mettra en lumière nos succès et les talents qui forment les équipes du secrétariat général.
Mieux connaître la richesse et la diversité de nos expertises, mieux nous connaître les uns les autres, mieux appréhender la façon dont nous travaillons ensemble, c’est le sens donné à ce nouveau format.
Je vous en souhaite une bonne lecture !
N°1 - Janvier 2025
Direction de la publication : Anaïs Lançon, directrice de la communication | Rédactrice en chef : Leila Moritz-Gonnet, cheffe du bureau de la communication interne | Responsable de la coordination : Cyrielle Pineda, responsable de communication | Comité rédactionnel : Sophie Namer, conseillère auprès du directeur des affaires juridiques, Sophie Geay, adjoint au chef du département des ressources et de la législation, Sylvian Xié, chef du CMVOA | Conception : Florence Chevallier, graphiste, Cyril Doual, chargé de projet intranet.
Contact : comm.interne@developpement-durable.gouv.fr


