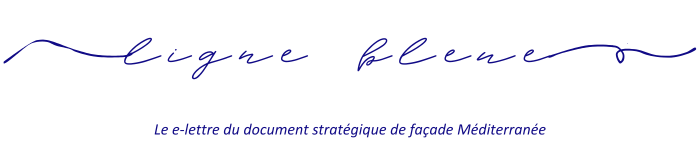
Ligne Bleue - Numéro 2 - Septembre 2024
Edito

Un été intense
Les acteurs de la façade ont été fortement mobilisés pour contribuer à la mise à jour de la stratégie de façade maritime mais aussi apporter leur appui à l’Etat pour rédiger la réponse à la Commission nationale du débat public. Je vous remercie pour tout ce travail qui a vocation à se poursuivre au cours de ces prochaines semaines. Cette stratégie de façade maritime s’est enrichie d’une nouvelle annexe sur la force juridique du document stratégique de façade (le régime d’opposabilité mais aussi le périmètre géographique). Les objectifs, indicateurs et cibles tant environnementaux que socio-économiques ont été complétés et précisés pour les rendre plus opérationnels et cohérents par rapport aux attentes du public. Enfin, les travaux sur les zones de vocation et la planification thématique (éolien, zone de protection forte et aquaculture) ont amorcé une ambition nouvelle afin de mieux mettre en valeur la dimension prospective des politiques publiques. L’article à la Une résume les principaux enseignements du débat qui, pour la Méditerranée peuvent se résumer en trois thématiques principales : des zones de protection forte sur le littoral et au large, l’érosion du littoral et le trio tourisme, plaisance et pêche de loisir.
Sommaire
- A la Une
- Débat public : quels enseignements
- Le DSF en action
- Le développement de l’éolien flottant en Méditerranée : études en cours
- Le DSF en action
- Ports Propres devient une norme mondiale
- Le DSF en action
- Signature du premier contrat de filière « industries et services nautiques » en Occitanie
- Le DSF en action
- Un an après : Alliance Posidonia
- Nouveaux dans le réseau
- Emmanuelle PELOUX, Responsable de mission…
- Olga BOLZINGER, Chargée de mission géomatique,…
- Sara SPADONI Chargée de mission pêche et…
- Sophie COUSIN, Chargée de mission Occitanie,…
- Sophie-Dorothée DURON Directrice du Parc…
- Nos grandes dates
- Le DSF et moi
A la Une

Débat public : quels enseignements
D’Argelès-sur-Mer à Bonifacio, en passant par Marseille, les représentants de l’Etat sont allés à la rencontre du grand public, des usagers et des professionnels de la mer et du littoral afin de débattre de l’avenir de la façade Méditerranée.
Durant cinq mois, de novembre 2023 à avril 2024, la Commission nationale du débat public a permis aux citoyens de s’informer et de s’exprimer au sujet de l’état de la façade Méditerranée et des transitions à opérer dans les prochaines années.
« La mer en débat » a porté sur l’état écologique des espaces maritimes et littoraux, sur les risques naturels auxquels nous sommes exposés et sur le développement et la coexistence des activités maritimes (incluant l’éolien en mer). Il s’agissait du premier débat public mutualisé organisé en France, marquant ainsi un important saut qualitatif vers une approche intégrée de tous les enjeux maritimes et littoraux.
Ce débat public s’intègre pleinement dans la procédure de mise à jour de la Stratégie de façade maritime de Méditerranée (volet stratégique du Document stratégique de façade) qui avait été adoptée en 2019. Ses enseignements ont dès lors vocation à guider l’Etat dans l’élaboration d’une nouvelle version de la Stratégie.
Au cours de 110 évènements très variés, plusieurs milliers de participants ont échangé avec la maîtrise d’ouvrage.
Deux affirmations principales sont ressorties de ces échanges :
- la Méditerranée est « une mer en voie de saturation et dont l’état de la biodiversité et des habitats marins, particulièrement dégradé, nécessite de nouvelles ambitions » ;
- « La pression devrait être allégée, que ce soit par l’incitation, la régulation, mais aussi, si nécessaire, par des interdictions ou des contraintes plus fortes, et sur la base de vocations clarifiées et simplifiées pour les espaces maritimes ».
Bien que dans les faits, certaines données soient encourageantes (la qualité des eaux de baignade notamment, ou la possible restauration active de l’herbier de posidonie), la biodiversité marine et les écosystèmes marins sont très fortement menacés par les différentes pressions anthropiques.
Par ailleurs, il semble évident que l’acceptabilité sociale de certaines activités a atteint ses limites.
Des interpellations sont ainsi remontées, notamment, sur les points suivants :
- labellisation de « zones de protection forte dans la bande côtière, là où les enjeux et les pressions sont élevés » ;
- labellisation de « zones de protection forte au large » ;
- « action plus déterminée sur le trait de côte, associant les citoyens, sur la base de moyens sécurisés à long terme » ;
- « avenir du modèle touristique de masse et conséquences de la surfréquentation » ;
- « régulation de la navigation de plaisance et de la pêche de loisir » ;
- « effets de la croisière sur les villes d’accueil ».
La question du déploiement de l’éolien en mer a été longuement débattue. Le public et les acteurs semblent plutôt favorables à la mise en service de fermes éoliennes en mer Méditerranée mais sous conditions : des garanties sont demandées et des clarifications restent nécessaires. La demande de prise en compte des études environnementales en cours de réalisation apparaît consensuelle. Le maintien de l’activité de pêche professionnelle dans et aux abords des parcs éoliens est souhaité par la profession. La localisation et la densité des parcs font débat (y compris le chevauchement ou non avec des aires marines protégées, voire avec des zones de protection forte) avec cependant un consensus sur le souhait d’éloigner au maximum les futurs parcs des côtes.
La décision de l’Etat concernant la prise en compte de ces enseignements sera transmise à la Commission nationale du débat public le 26 septembre 2024. Cette décision sera rendue publique.
Le DSF en action

Le développement de l’éolien flottant en Méditerranée : études en cours
Entre obligations légales et programmes de recherches, le développement de l’éolien commercial en Méditerranée renforce la connaissance des enjeux environnementaux, géomorphologiques et anthropologiques sur le golfe du Lion. Ces études doivent également permettre de déterminer les zones de moindre impact pour la planification de l’éolien.
A l’heure du choix des premiers lauréats de l’appel d’offre n°6, de nombreuses études sont achevées ou en cours sur le golfe du Lion. L’environnement n’est cependant pas la seule composante de ces études puisqu’elles traitent également du volet économique et social des activités humaines du golfe du Lion. Ces études sont réalisées selon différentes échelles :
• sur les zones potentielles pour les futurs parcs
• sur l’aire d’étude pour le raccordement
• sur l’ensemble du golfe du Lion
Études techniques :
Les campagnes de mesures du vent permettent de préciser le potentiel d’électricité générée par un parc éolien dans la zone étudiée et les conditions de vague et de courant. Les mesures bathymétriques, sédimentologiques, géophysiques et géotechniques vont permettre de déterminer les conditions techniques d’implantation des éoliennes dans cette zone maritime. Ces campagnes sont essentielles pour déterminer les coûts des projets.
Les zones 1 et 2 ont entièrement été couvertes, tandis que les zones 3 et 4 seront finalisées en fin d’année 2024.
Étude sur les oiseaux migrateurs :
Amorcé en avril 2021, le programme Migralion porté par l’OFB a pour objectif de venir compléter de manière inédite et significative la connaissance sur l’utilisation du golfe du Lion par les migrateurs terrestres, l’avifaune marine et les chiroptères. Les campagnes de suivi télémétrique de différentes espèces d’oiseaux, d’observations en mer par bateau, l’installation de radars ornithologiques à la côte et le développement de méthodes permettant l’analyse des différentes données produites par ce programme et issues d’autres projets se poursuivront pour une période de trois ans.
Un rapport intermédiaire a été produit en 2022 et mis à disposition du public dans le cadre de la mer en débat. Les résultats finaux sont attendus pour 2025
État initial de l’environnement :
L’État est en charge de la réalisation de l’état initial de l’environnement. Le marché, remporté par le groupement BRLI/Biotope, prévoit notamment des études bibliographiques (tourisme, paysage, pêche, activités humaines, etc.) ainsi que des analyses de terrain qui s’étalent sur une période de deux ans en fonction des compartiments et du type d’analyse.
Un premier rapport intermédiaire est attendu pour octobre 2024 afin de rendre compte des 6 premiers mois de campagnes.
Étude tourisme :
L’État et les Régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec leurs Comités régionaux du tourisme, ont engagé une étude sur les impacts du développement de parcs commerciaux d’éoliennes en mer Méditerranée sur le tourisme.
L’étude sera constituée de trois phases :
Phase 1 : Recueil et analyse de retours d’expérience, en France et à l’étranger, sur les impacts des parcs éoliens en mer et leur raccordement sur le tourisme de la destination, et les mises en tourisme des projets ;
Phase 2 : Étude des impacts potentiels de la mise en service de parcs éoliens flottants commerciaux en Méditerranée sur l’activité touristique locale, sur terre comme sur mer ;
Phase 3 : Étude des offres touristiques qui pourraient être développées autour de l’implantation des parcs éoliens commerciaux en mer
Les phases 1 et 2 sont finalisées. La phase 3 est en cours et devrait s’achever en fin d’année 2024
Étude paysage et patrimoine :
L’État a engagé une étude sur l’impact du développement de l’éolien en mer sur le paysage et le patrimoine du golfe du Lion. Entre ambiance paysagère et visibilité potentielle, cette étude se divise en deux phases :
Phase 1 : Établir un état des lieux paysager et patrimonial de la façade maritime du golfe du Lion, afin de mieux identifier les sensibilités paysagères des différents espaces du golfe du Lion
Phase 2 : Produire la notice paysagère contribuant à l’évaluation évaluation environnementale stratégique du volet éolien en mer, dans l’optique de confronter l’impact de la planification de l’éolien sur les paysages méditerranéens.
Étude sur l’activité de pêche professionnelle :
L’État a souhaité établir un état des lieux de la spatialisation de l’activité de pêche professionnelle dans le golfe du Lion. Cette étude, bien que limitée par la qualité des données disponibles géolocalisées, permet de spatialiser une partie importante de l’activité de la flottille chalutière. Cette
L’ensemble de ces études permettront de répondre au besoin de connaissance nécessaire à la planification générale de l’éolien flottant en Mer Méditerranée.
Le DSF en action

Ports Propres devient une norme mondiale
Seule et unique norme mondiale en environnement pour les ports de plaisance, la norme ISO 18725 est née le 5 juin 2024.
La création d’une norme mondiale est un projet qui a été porté par l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco (UPACA), avec ses partenaires dont la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Ademe, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la DIRM, la DREAL, les unions et associations des ports de plaisance des autres régions françaises et, des collectifs d’associations environnementales dont Ecogestes. Cette création s’inscrit dans une suite logique.
En 2008, la certification française Ports Propres avait déjà été créée puis son extension en norme européenne Ports Propres concrétisée en 2012. En 2018, ce dispositif s’est enrichi d’une option : la certification AFNOR Ports Propres Actifs en Biodiversité.
Les unions et associations de ports de plaisance des autres régions notamment l’Union des ports de plaisances d’Occitanie et la Fédération Française des Ports de Plaisance ont suivi toutes les étapes du projet, pour un redéploiement optimal régional et national avec cette nouvelle reconnaissance mondiale. En effet, plus de 100 ports français sont déjà certifiés Ports Propres et, devraient dans une logique de continuité, se présenter à la certification mondiale Iso 18 725.
Les grandes lignes de cette norme mondiale reprennent l’intégralité des référentiels des 2 certifications françaises et européennes avec leurs grands principes :
• Lutte contre les pollutions récurrentes et les pollutions accidentelles ;
• Économie et ressources alternatives (eau et énergie) ;
• Pratiques et équipements pour favoriser la biodiversité dans les ports de plaisance ;
• Formation du personnel ;
• Sensibilisation des usagers.
Le DSF en action

Signature du premier contrat de filière « industries et services nautiques » en Occitanie
La préfecture de région Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et la Fédération des industries nautiques (FIN) se sont associées pour accompagner la filière nautique. Ils sont co-signés le vendredi 5 avril dernier le premier contrat de filière « industries et services nautiques ».
A l’instar des contrats de filière lancés en Occitanie pour la conchyliculture et la pêche, cette démarche pionnière s’inscrit dans les ambitions du Plan littoral 21 et en faveur d’un nautisme durable et responsable. Outil de déclinaison opérationnelle des objectifs et actions du Document stratégique de façade Méditerranée, le contrat illustre la volonté de rassembler tous les acteurs publics et privés qui interviennent dans le champ du nautisme, en se dotant d’une feuille de route collective.
Dès 2023, l’État, la Région Occitanie et la FIN ont initié le contrat de filière des industries et des services nautiques d’Occitanie afin de proposer une feuille de route permettant d’accompagner les entreprises mais aussi d’accélérer la transition environnementale de la filière. Afin de permettre sa réalisation et sa mise en œuvre, la Région Occitanie a signé avec la FIN une convention-cadre qui définit les conditions du partenariat et l’accompagne financièrement, sur trois ans.
La vocation de ce contrat est d’accompagner les entreprises pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain et conforter le poids et la dynamique économique des acteurs du nautisme en Occitanie. Il doit notamment permettre de répondre aux besoins en recrutement et en formation, mais également à la nécessité pour la filière de rester compétitive et attractive par l’innovation et de poursuivre sa transition écologique.
L’objectif de ce contrat de filière est de définir des enjeux et des objectifs partagés pour la période 2024/2027, assortis d’un ensemble d’actions concrètes répondant aux axes stratégiques identifiés. Les acteurs impliqués dans ce contrat de filière s’engagent à coconstruire un programme d’actions opérationnel répondant aux grands enjeux de la filière, que sont :
• La transition environnementale de la filière, à la fois au niveau des entreprises, des produits mais également au niveau des pratiquants, en favorisant l’innovation, le développement de la filière de déconstruction des bateaux en fin de vie, la sensibilisation des plaisanciers aux bonnes pratiques et à la protection du milieu marin ;
• L’emploi et la formation avec pour triple objectif l’attractivité des métiers de la filière, le développement d’une offre de formation adaptée aux besoins actuels et la fidélisation des salariés, afin de répondre aux problématiques de recrutement auxquelles sont confrontées les entreprises du territoire ;
• Le développement et le rayonnement de la filière à travers l’implantation de nouvelles entreprises, l’innovation et la promotion des industries et des services nautiques d’Occitanie.
Le DSF en action

Un an après : Alliance Posidonia
Depuis son lancement le 29 juin 2023 la dynamique Alliance Posidonia a été très active ! En un an plus d’une trentaine de structures ont rejoint la démarche. Les membres fondateurs ont participé à une dizaine d’évènements pour faire connaître Alliance Posidonia et valoriser les actions des structures engagées et des outils de communication ont vu le jour.
Alliance Posidonia est une démarche innovante car elle associe des acteurs publics, privés et des ONG. L’objectif est d’instaurer une dynamique collective forte et capable de faire émerger une véritable prise de conscience des élus, des plaisanciers, des acteurs économiques et sociaux sur la façade méditerranéenne pour la préservation de la posidonie.
Parmi les membres fondateurs on compte la Préfecture maritime de la Méditerranée, la Direction interrégionale de la mer Méditerranée ; l’Office français de biodiversité ; l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ; les conseils régionaux Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ; la Fédération des industries nautiques ; l’Union des ports de plaisance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco ; l’Union des villes portuaires d’Occitanie ; le CPIE Iles de Lérins et le WWF. Les membres fondateurs se réunissent régulièrement au sein d’un comité de pilotage afin de discuter des candidatures adressées par les structures souhaitant rejoindre la dynamique d’Alliance Posidonia. Le principe de volontariat est fondamental : les structures sont force de proposition sur les actions qu’elles souhaitent mettre en œuvre pour la préservation de la posidonie. Le signataire s’engage à mettre en place ses engagements sur une durée de trois ans. Au terme de ces trois ans, il pourra reconduire ses engagements ou les réviser.
Depuis juin 2023, 35 structures ont rejoint Alliance Posidonia :
- 13 ENTREPRISES : Fountaine-Pajot ; Groupe Beneteau ; RX France ; USHIP ; Seamagine eco navigation ; Form’actuel ; Nautic Spot ; Dream Yacht ; Windelio ; OP Sathoan ; Seaneo ; GMPRO ; Paradis des bulles.
- 17 PORTS DE PLAISANCE : Les Marines de Cogolin ; Port Gallice ; Port Héracléa ; Port La Napoule ; ZMEL Port Miou ; Port des Embiez ; Ports d’Hyères (x5) ; Port du Lavandou ; Port du Crouton ; Port de Saint Jean Cap Ferrat ; Port de Banyuls ; Port Charles Ornano ; Port de Saint Tropez.
- 1 COLLECTIVITÉ : Ville d’Agde
- 2 ASSOCIATIONS : CPIE Bassin de Thau et CPIE Bastia U-marinu
- le Parlement de la mer Occitanie et l’Accord RAMOGE
Pour sensibiliser au rôle essentiel des herbiers et des banquettes de posidonie, présenter le rôle d’Alliance Posidonia puis donner envie à d’autres structures de s’engager pour la préservation de cette espèce protégée, les membres d’Alliance Posidonia partent à la rencontre des acteurs socio-économiques. Au cours de cette première année ils ont participé au Yachting festival de Cannes, au salon des sociétés partenaires de l’UPACA, à la Monaco Ocean Week, au Salon international du multicoque à La Grande Motte, à la signature des chartes d’engagement pour les plages de caractère au Lavandou et au forum Neptunalia de Toulon.
Parce que la communication est primordiale pour faire connaître Alliance Posidonia, ses membres, les structures engagées et valoriser les actions mises en œuvre, plusieurs outils ont été développés. Les membres de l’Alliance se réjouissent de l’arrivée toute récente d’un site internet dédié.
Ce site propose des données sur les fonctions écologiques et les services écosystémiques de la posidonie ; une cartographie des structures engagées ainsi que toutes les informations relatives aux modalités de candidature. Une vidéo sur les bonnes pratiques de l’ancrage a également été élaborée et sera largement diffusée.
Nouveaux dans le réseau
Emmanuelle PELOUX, Responsable de mission Région Sud et Corse, Fédération des Industries Nautiques

Olga BOLZINGER, Chargée de mission géomatique, Office Français de la Biodiversité - Délégation de façade maritime Méditerranée

Sara SPADONI, Chargée de mission pêche et aquaculture, Office Français de la Biodiversité - Délégation de façade maritime Méditerranée

Sophie COUSIN, Chargée de mission Occitanie, Fédération des Industries Nautiques

Sophie-Dorothée DURON, Directrice du Parc national de Port-Cros

Nos grandes dates
26 et 27 septembre : Nice Climate Summit
1 octobre : Journée d’information sur l’artificialisation en Occitanie
3 octobre : Comité technique du Document stratégique de façade
8 et 9 octobre : Les Rencontres Stratégiques de la Méditerranée au Palais Neptune de Toulon
10 octobre : Club Med des services instructeurs mer et littoral en Corse
15, 16 et 17 octobre : Atelier technique de façade de l’OFB
17 octobre : Formation aux enjeux littoral et mer aux enseignants de l’acamdémie de Nice aux Iles de Lérins
23 et 24 octobre : Conférence finale du projet REGINA MSP-MSP GREEN et les 10 ans de la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin au Palais du Pharo à Marseille
5 novembre : Comité régional de la biodiversité à Marseille
5 et 6 novembre : Salon du Littoral 2024 au palais des congrès de la ville de la Grande Motte.
18 novembre : Forum mouillages au Palais du Pharo à Marseille
Le DSF et moi

Emeline VANPEPERSTRAETE, Chargée Environnement Maritime de la Région Occitanie
La Région Occitanie porte une politique volontariste de conciliation des activités maritimes avec la préservation du milieu marin. Le DSF s’appuyant sur ces mêmes fondamentaux, je participe aux travaux du COTECH, aux COPIL des stratégies de façade (mouillage, plongée, restauration écologique…) et au développement d’appels à projets interrégionaux, pour un enrichissement mutuel de nos actions.
Le Parlement de la Mer Occitanie (dont le GT Environnement que j’anime) sert de lieu de concertation pour les sujets DSF. Les actions menées en Occitanie par les partenaires (gestionnaires d’aires marines, associations, ports de plaisance…) et cofinancés par la Région Occitanie (ZMEL, Faisons des Merveilles, connaissance des fonds meubles, expérimentation de valorisation de sédiments de dragage…) permettent de mettre en œuvre de façon concrète ces orientations interrégionales, nourrissant ainsi le bilan du DSF et les réflexions de son évolution.
Comité de rédaction : Mission Coordination des… : Comité de rédaction : Mission Coordination des Politiques de la Mer et du Littoral Contact : Contact : mission-coordination.dirm-med@mer.gouv.fr
Pour vous désinscrire de cette e-lettre : merci d'envoyer un e-mail à mission-coordination.dirm-med@mer.gouv.fr