
La e-lettre bimestrielle de la Direction des affaires juridiques
N°4 du 16 juillet 2024 - Angle droit 27
Edito

La protection fonctionnelle est due par la collectivité publique aux agents qu’elle emploie afin de prévenir ou prendre les mesures adéquates pour faire cesser et remédier à tout acte préjudiciable qu’ils subissent du fait de l’exercice de leur fonction. De telles situations apparaissent malheureusement de plus en plus fréquentes et le Gouvernement, conscient de cette situation, a d’ailleurs lancé en septembre dernier un plan de protection des agents publics pour répondre aux violences dont ils peuvent faire l’objet.
L’article L. 134-4 du code général de la fonction publique dispose que « lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ». Cet article prévoit en outre que les agents publics bénéficient également de cette protection lorsque, pour de tels faits, ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale.
Ces dispositions ont généré de nombreuses questions car si elles incluent un certain nombre de cas, elles en excluent d’autres, dans lesquels concrètement les agents ne pourront notamment pas bénéficier de la prise en charge de leurs frais d’avocat.
Par une décision du 4 juillet 2024 (n°2024-1098 QPC), le Conseil constitutionnel a d’abord jugé que, sauf à méconnaître le principe d’égalité, les agents doivent pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat. Dès lors, le fait d’exclure le bénéfice de cette protection aux personnes entendues librement, méconnaît le principe constitutionnel d’égalité.
Au regard du caractère manifestement excessif d’une abrogation immédiate des dispositions en cause, qui priverait nombre d’agents du bénéfice de la protection, il reporte néanmoins au 1er juillet 2025 cette abrogation et indique que dans cette attente, il faut lire les dispositions comme incluant l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre.
Il faudra ainsi que, à l’horizon d’une année, le législateur amende la loi. L’histoire de la protection fonctionnelle, née avec l’article 75 de la constitution de l’an VIII instituant une première protection des fonctionnaires contre les poursuites pénales, va donc connaître une nouvelle étape dans les mois à venir.
Zoom sur …
La loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 organise la fusion entre une autorité administrative indépendante (AAI), l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), et un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Elle crée au 1er janvier 2025 une nouvelle AAI, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).
Actuellement, l’ASN est notamment chargée de rendre les décisions en matière de conformité aux règles de sûreté nucléaire et prend à ce titre environ 1 800 décisions par an. Pour les dossiers complexes nécessitant une expertise (environ 300 par an), elle s’appuie sur l’expertise technique de l’IRSN.
Dans un contexte de relance du nucléaire civil (nouveaux réacteurs EPR2 et poursuite du fonctionnement du parc actuel), l’objectif de la réforme est d’améliorer l’efficience des procédures en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et l’attractivité des métiers du nucléaire.
L’ASNR rassemblera désormais l’essentiel des compétences de l’ASN et de l’IRSN. Elle sera un interlocuteur unique, indépendant du gouvernement et des exploitants, chargé du contrôle, de l’instruction des dossiers de sûreté et de la radioprotection dans toutes ses composantes (contrôle, expertise, recherche, formation). Elle pourra ainsi être reconnue comme un établissement exerçant des missions de recherche et bénéficier des prérogatives attachées à ce statut (accueil de chercheurs, de doctorants, etc.).
Deux activités de l’IRSN ne seront pas transférées à l’ARSN : la direction de l’expertise nucléaire de défense (DEND), appui technique de l’autorité de sûreté nucléaire défense (ASND, qui contrôle les installations et les activités intéressant la défense) qui relèvera du ministère des armées, et les activités concernant la fourniture et l’exploitation de dosimètres à lecture différée, qui relèveront du Commissariat à l’énergie atomique (CEA).
Cette réforme, par son caractère novateur, posait, au-delà de sa complexité technique et organisationnelle, plusieurs questions juridiques qui ont fait l’objet de discussions devant le Conseil d’État puis à l’occasion de la saisine du Conseil constitutionnel.
Tout d’abord, il convenait de déterminer si une AAI, par définition non dotée de la personnalité morale et relevant donc de l’État, pouvait se voir transférer des salariés de droit privé sans la requalification des contrats en contrats de droit public prévue par l’article L. 1224-3 du code du travail.
Le Conseil d’État, dans son avis, rappelle que « si les agents non fonctionnaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont en principe des agents de droit public quel que soit leur emploi, le législateur a la faculté de permettre le recours à des salariés régis par le code du travail dans un service public administratif ou un établissement public à caractère administratif (cf. notamment, décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, à propos des « emplois d’avenir ») ». Il souligne toutefois que, « si elle ne se heurte ainsi à aucun obstacle d’ordre constitutionnel, cette solution (…) doit être regardée comme exceptionnelle et liée aux circonstances de l’espèce, qui conduisent, pour parvenir à une structure unique de contrôle et d’expertise dans le domaine nucléaire, à intégrer, au sein d’une AAI, les missions et les moyens d’un EPIC. »
L’article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des AAI et des API ne permettant pas à ces entités de recruter des agents contractuels de droit privé, il a ainsi été intégré au projet de loi des dispositions dérogatoires portant autant sur le transfert des salariés que sur le recours par l’ASNR à des agents de droit privé.
Une autre dérogation a été retenue pour la mise à disposition, auprès du ministère des armées, des salariés de droit privé de l’actuelle DEND. En effet, la loi prévoit que ces agents seront, au moment du transfert de leurs contrats de travail au CEA, mis à disposition d’office du ministère de la défense, dans le cadre d’un régime « sur-mesure » (mise à disposition d’une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à la demande des intéressés, soumission au régime de droit commun applicable aux agents publics en application de l’article L. 334-1 du code général de la fonction publique).
Enfin, la saisine du Conseil constitutionnel a été l’occasion d’aborder les questions tenant à l’indépendance entre-elles des fonctions de la nouvelle autorité. Les députés requérants considéraient le cumul des fonctions d’expertise et de décision comme un recul injustifié pour la prévention des risques nucléaires, privant de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant de la Charte de l’environnement et méconnaissant les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de protection de la santé.
Dans sa décision n° 2024-868 DC du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel a d’abord jugé que les fonctions d’expertise transférées n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les obligations auxquelles sont soumises les activités nucléaires civiles dont la nouvelle autorité est chargée de contrôler le respect. Il ajoute qu’en tout état de cause, dans la mesure où la loi prévoit qu’une distinction doit être opérée entre les fonctions d’expertise et de décision, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement.
En outre, le Conseil constitutionnel constate que le renvoi au règlement intérieur pour définir les règles de fonctionnement et d’indépendance de l’autorité, et notamment celles concernant les activités d’expertise et de recherche afin de prévenir les conflits d’intérêts, ne place pas le législateur dans une situation d’incompétence négative, y compris en ce qui concerne la définition de règles déontologiques applicables à la rémunération pour services rendus.
Le Conseil constitutionnel déclare donc la loi conforme à la Constitution.
La mise en œuvre de cette loi nécessite encore d’adopter, d’ici au 1er janvier 2025, un certain nombre de textes d’application, notamment en matière de recrutement, de conditions d’emplois et d’adaptation des instances de dialogue social. L’un des enjeux de la réforme est en effet de pérenniser le transfert et le recrutement de futurs experts de haut niveau par des conditions d’emploi les plus propices à assurer un maintien en compétence et un développement de carrière cohérent à leurs parcours tant au sein de l’ASNR que du CEA. Un autre enjeu majeur est également d’assurer, malgré leur caractère hybride, le fonctionnement des instances représentatives et collégiales de l’ASNR.
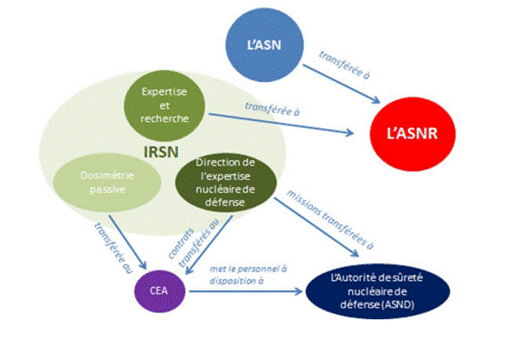
Source : Revue Générale Nucléaire - https://rgn.publications.sfen.org/
L'actualité jurisprudentielle
Droit administratif général
Pouvoir règlementaire – Absence de compétence ministérielle pour définir les conditions d’une aide du seul fait de la mise à disposition des crédits par la loi de finances et le décret de répartition – Conclusions contestant le refus d’étendre le champ d’un acte incompétemment édicté – Rejet des conclusions
À acte incompétent, refus d’étendre ne nuit
Afin de permettre aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de faire face à la hausse des prix de l’énergie, le ministre délégué en charge des transports a annoncé, en décembre 2022, la mise en place d’une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros pour les AOM hors Île-de-France. Cette annonce a été suivie d’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 augmentant les crédits du programme 203 « infrastructures et services de transports » d’une somme de 300 millions d’euros. Un arrêté ministériel du 18 avril 2023 a ultérieurement défini les conditions et modalités d’attributions de l’aide.
La région Auvergne-Rhône-Alpes a initialement demandé au Conseil d’État l’annulation, dans son ensemble, de cet arrêté. Avant l’audience, la région requérante a toutefois restreint le périmètre de ses conclusions, afin de ne demander l’annulation de l’arrêté qu’en tant qu’il n’ouvrait pas le champ de l’aide aux régions.
Le Conseil d’État, après avoir relevé d’office le moyen, a retenu l’incompétence du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre délégué chargé des transports. En effet, dès lors que « les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d’ouvrir à l’administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d’attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci », ni la loi de finances pour 2023, ni son décret de répartition ne conféraient une compétence aux ministres pour définir les conditions et modalités d’attribution d’une aide aux AOM.
Néanmoins, au regard du nouveau périmètre des conclusions de la requérante, le Conseil d’État ne peut que rejeter la requête. Ne pouvant statuer ultra petita, la Haute juridiction ne peut en effet annuler l’arrêté dans son ensemble. En outre, dès lors que les ministres signataires sont incompétents pour adopter l’arrêté contesté, ils ne pouvaient en tout état de cause étendre en ce sens le champ de l’aide.
Energie
Régime contentieux dérogatoire au droit commun – Délai de jugement sous peine de dessaisissement – Egalité des citoyens devant la justice
Dans ce contexte, un décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 instaure, pendant quatre ans, des règles spéciales en matière de contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie renouvelable, hors énergie éolienne (méthanisation, photovoltaïque, géothermie et hydroélectricité d’une certaine importance). Ce décret, dont les dispositions ont été codifiées à l’article R. 311-6 du code de justice administrative (CJA), prévoit non pas des règles spéciales de compétence mais une obligation pour chaque niveau de juridiction de statuer dans un délai de dix mois, sous peine de dessaisissement au profit du juge supérieur. Il fixe également, pour toutes les décisions qu’il liste, un délai de recours contentieux de deux mois ne pouvant être prorogé par l’exercice d’un recours administratif.
Le Conseil d’État rejette les requêtes dirigées contre ce décret.
Les critiques les plus nombreuses portaient sur l’instauration d’un délai de jugement sous peine de dessaisissement. Un tel régime, s’il existe déjà en contentieux électoral et en matière de recours contre les plans de sauvegarde de l’emploi, demeure exceptionnel et doit être justifié par un intérêt général suffisant à accélérer la procédure juridictionnelle, eu égard à l’effet d’éviction des autres dossiers qu’il crée. Le Conseil d’État constate en l’espèce que ce régime n’a pas pour effet de supprimer un degré de juridiction et se borne à aménager les délais de jugement, sans priver les justiciables de l’accès à un juge. Il juge par conséquent que les dispositions du décret, qui présentent un caractère temporaire, sont prises dans l’objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, et ne méconnaissent pas le principe d’égalité entre les justiciables. Il écarte également, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le Conseil d’État juge également qu’en prévoyant un délai de recours contentieux de deux mois non susceptible de prorogation, le pouvoir règlementaire n’a pas porté d’atteinte illégale au droit à un recours juridictionnel effectif.
CE, 18 juin 2024, SEC Grand Paris, n° 488823, aux Tables
Certificats d’économies d’énergie - Versement libératoire – Absence de qualification de sanction
Qualification juridique de la décision prononçant une pénalité libératoire à l’encontre d’une société qui n’a pas rempli ses obligations d’économies d’énergie
Dans ces affaires, les requérants demandaient l’annulation de décisions leur imposant un versement libératoire et des titres de perception pris pour l’application de ces décisions. Ils considéraient en particulier que les garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 222-3 et L. 222-5 du code de l’énergie, relatives aux sanctions administratives, n’avaient pas été respectées.
Le Conseil d’État juge, dans la décision n° 474361, que le versement libératoire, dont les obligés doivent s’acquitter lorsqu’ils ne respectent pas leurs obligations en matière d’économies d’énergie, est « dépourvu de finalité répressive » et « ne revêt pas la nature d’une sanction ayant le caractère de punition ». C’est en effet une mesure différente « des mesures prévues par les dispositions du chapitre II, intitulé « Les sanctions administratives et pénales », du même titre, prononcées à l’issue de la procédure régie par les dispositions des articles L. 222-3 et L. 222-5, notamment la sanction pécuniaire instituée au 1° de l’article L. 222-2 (…) ».
Dès lors, la décision prononçant une pénalité libératoire sur le fondement de l’article L. 221-4 du code de l’énergie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 222-5 du code de l’énergie relatif à la procédure de sanction.
Le Conseil d’État juge également, dans la décision n° 488823, que la décision mettant à la charge des obligés un versement libératoire « n’est pas au nombre de celles mentionnées à l’article R. 222-12 du même code pouvant faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État ». En effet, l’article R. 222-12 du code de l’énergie porte sur les décisions du ministre chargé de l’énergie prononçant des sanctions. Le tribunal administratif est par conséquent compétent pour connaître en premier ressort des décisions imposant un versement libératoire.
Environnement
Conditions de détention des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants – Appréciation de la légalité de la décision attaquée à la date de son adoption
Un hippopotame qui se balance sur la toile du recours pour excès de pouvoir
L’association One Voice a saisi le préfet de la Drôme d’une demande d’abrogation d’un arrêté du 24 octobre 2008 autorisant le cirque Muller et son exploitant à détenir et présenter au public un hippopotame dénommé « Jumbo ».
Dans son pourvoi, l’association demandait l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 février 2022 rejetant sa demande, notamment au motif que la cour avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les rapports présentés réalisés postérieurement à la décision attaquée.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi en jugeant que c’est à bon droit que la cour a examiné la légalité de la décision attaquée à la date de son adoption et pas à la date à laquelle la formation de jugement a statué. Ce faisant, bien qu’y ayant été invité par son rapporteur public, il n’applique pas à un nouveau domaine le raisonnement retenu dans ses jurisprudences Américains Accidentels (CE, Ass., 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°424216, au recueil) et Confédération paysanne (CE, 7 février 2020, Confédération paysanne, n° 388649, au recueil) relatif à l’appréciation dynamique, par le juge de l’excès de pouvoir, de la légalité des décisions de refus d’abroger ou d’adopter des mesures règlementaires. Si le Conseil d’État a pu, par le passé, étendre ce courant jurisprudentiel à certaines décisions individuelles après un examen au cas par cas (pour le refus d’abroger un décret d’extradition : CE 10 juin 2020, M. E, n° 435348, au recueil ou le refus de récupération d’aides d’État : CE 18 mars 2020, Région Ile-de-France, n° 396651, aux tables), il l’a toujours fait avec une légitime prudence et s’y refuse en cette matière pour conserver un contrôle plus classique.
Protection des monuments et sites naturels – Appréciation des données scientifiques, historiques et archéologiques
Gergovie, fin d’une bataille scientifique et juridique
Le Conseil d’État juge que si les requérants contestent la localisation de la bataille de Gergovie, ils fondent leur argumentation sur des travaux scientifiques isolés alors qu’ « il ressort des pièces du dossier que (…) les auteurs du décret se sont appuyés sur des données historiques et archéologiques dont il apparaît, au vu des éléments produits, qu’elles ne font plus aujourd’hui sérieusement débat au sein de la communauté scientifique ». Ainsi, le classement répond, en l’état des travaux de recherche, au critère d’intérêt historique posé par la loi et le périmètre retenu pour le classement vise à former un ensemble cohérent. Dans ces conditions, le Conseil d’État rejette la requête.
Mer
Redevance pour service rendu – Tarifs de station de pilotage – Montant proportionné
Qualification des tarifs des stations de pilotage en redevance pour service rendu
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil d’État du 28 novembre 2018, n°413839, SNCF Réseau, selon laquelle une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d’une part, que les opérations qu’elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l’État et, d’autre part, qu’elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d’usagers déterminés. L’application d’un taux réduit des tarifs de pilotage aux capitaines de navires ayant une licence de capitaine pilote ne remet pas en cause cette qualification dès lors que la redevance est la contrepartie de la disponibilité du service de pilotage auquel ces capitaines peuvent faire appel à tout moment et non pas le recours effectif à ce service.
Reprenant les critères introduits par la jurisprudence d’assemblée du 16 juillet 2007, n° 293229, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital, le Conseil d’État juge que les tarifs de pilotage ne sont pas d’un montant disproportionné par rapport à la valeur du service. Celui-ci peut intégrer, outre le coût de revient du service ou de la prestation, d’autres paramètres tels que la valeur économique. Parmi les charges de personnel des stations de pilotage figure la « masse partageable » qui comprend les retenues opérées sur les recettes de la station pour l’alimentation des caisses de retraite complémentaires et la rémunération des pilotes. La masse partageable est donc liée au coût du service. Aussi, la cour administrative d’appel de Marseille n’était pas tenue de s’assurer du détail de la masse partageable, le cas échéant en mettant en œuvre ses pouvoirs d’instruction, pour pouvoir apprécier le caractère proportionné des tarifs.
Sécurité nucléaire
CE, 26 avril 2024, MTE c/ M. B, n° 465070, Inédit
Accès à une installation d’importance vitale – Secret de la défense nationale – Pouvoirs du juge
Pouvoirs généraux de direction de la procédure du juge administratif et saisine de la Commission du secret de la défense nationale
Les deux litiges portés devant le Conseil d’État concernaient les conditions dans lesquelles l’accès à des centrales nucléaires peut être interdit à certaines personnes en raison d’un risque de terrorisme.
Pour juger que les refus d’accès aux centres nucléaires de production d’électricité concernés étaient entachés d’illégalité, faute pour l’administration d’apporter un commencement de preuve du risque allégué, la cour administrative d’appel s’était fondée sur la circonstance qu’il n’était justifié d’aucune saisine de la commission du secret de la défense nationale en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense. Or, dans chacune des deux affaires, la ministre faisait valoir le contenu d’une note classifiée au niveau confidentiel défense.
Le Conseil d’État juge qu’« en statuant ainsi, alors qu’en tant que juridiction saisie du litige, il lui appartenait, si elle estimait ne pas disposer d’éléments suffisamment circonstanciés, de demander, ainsi que le prévoient les dispositions de L. 2312-4 du code de la défense, la déclassification de cette note (…) à l’autorité administrative en charge de la classification à laquelle il revenait ensuite de saisir pour avis la commission du secret de la défense nationale, elle a entaché son arrêt d’erreur de droit ».
Concluant que la ministre de la transition énergétique est fondée à demander l’annulation des arrêts attaqués, le Conseil d’État a, en conséquence, annulé ces arrêts et renvoyé les affaires à la cour administrative d’appel de Lyon.
Urbanisme
Urbanisme - Permis de construire - Composition du dossier
Pièces manquantes et délai d’instruction : du nouveau sur l’instruction des demandes de permis de construire
Il rappelle qu’il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2 et R. 423-19 et suivants du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans le délai de trois mois, l’ensemble des pièces manquantes, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration reçoit ces pièces et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est alors, en principe, tacitement accordé. À l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai.
Le Conseil d’État rappelle également que le code de l’urbanisme prévoit, par ses articles R. 423-38 et suivants, que la demande de pièces manquantes doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour que le point de départ du délai d’instruction soit reporté et qu’une demande de pièces manquantes notifiée après la fin du délai d’un mois ou portant sur des pièces qui ne sont pas prévues par le code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction.
Il juge que ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque le demandeur ne produit pas la pièce demandée, à ce que l’autorité compétente lui réclame à nouveau cette pièce, même passé le délai d’un mois depuis le dépôt de la demande de permis de construire. Cette demande est toutefois sans incidence sur le cours du délai d’instruction et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme du délai de trois mois.
Urbanisme - Règles générales d’utilisation du sol - Application de la loi sur le littoral
Sur la notion d’agrandissement des constructions existantes en zone littorale
Le tribunal administratif de Bastia, par un jugement avant dire droit, a transmis au Conseil d’État une question de droit visant à savoir si, dans les communes littorales, le projet d’agrandissement d’une construction existante doit être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, le Conseil d’État précise le sens à donner à la notion de simple agrandissement susceptible d’être autorisé sans méconnaître les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il juge que « le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. ».
En deuxième lieu, le Conseil d’État précise que « le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement » et que « s’agissant toutefois des constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi. ».
En dernier lieu, le Conseil d’État précise que la nouvelle rédaction de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, qui supprime la possibilité d’extension de l’urbanisme en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, est sans incidence sur cette appréciation de la notion d’agrandissement.
L'actualité normative et consultative
Avis
Conscient que le changement climatique entraîne des effets nuisibles pour les milieux marins et les États insulaires, le Tribunal a, en premier lieu, considéré que les obligations des États parties s’appliquaient au changement climatique et à l’acidification des océans et que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre entraient dans la définition de pollution du milieu marin au sens de l’article 1er de la CNUDM. Partant, il appartient aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin (partie XII et notamment l’article 194 de la CNUDM) et de s’efforcer d’harmoniser leurs politiques à cet égard.
Il s’agit d’une obligation de diligence de niveau élevé, « compte tenu des risques aigus de préjudice grave et irréversible au milieu marin que font peser les émissions anthropiques de GES ».
En application de l’article 194 de la CNUDM, cette obligation conventionnelle exige également des États la mise en place d’un système national « comprenant une législation, des procédures administratives et un mécanisme d’exécution nécessaires pour réglementer les activités en question, et exerce la vigilance appropriée afin que ce système fonctionne efficacement, en vue d’atteindre l’objectif recherché ». Il a néanmoins été reconnu que cette obligation de diligence requise est une notion à caractère variable qui s’impose aux États en fonction des capacités et des ressources dont ils disposent.
Selon les conclusions du Tribunal, ces mesures doivent être déterminées en tenant compte des meilleures données scientifiques disponibles et des normes internationales pertinentes contenues notamment dans la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’accord de Paris, et en particulier l’objectif de limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Le Tribunal précise néanmoins que l’accord de Paris est distinct de la CNDUM et que, par suite, le respect de l’un n’est pas suffisant pour déduire l’absence de méconnaissance de l’autre.
En second lieu, le Tribunal a considéré que l’obligation générale de protection et de préservation du milieu marin telle énoncée à l’article 192 de la CNUDM, qui « s’applique à toutes les zones maritimes et peut être invoqué pour lutter contre toute forme de dégradation du milieu marin » constitue également une obligation de diligence requise – là encore de niveau élevé, compte tenu des risques aigus de préjudice grave et irréversible au milieu marin que font peser les incidences du changement climatique et l’acidification des océans. Il appartient, par ailleurs, aux États du pavillon et à ceux dont les ressortissants participent à des activités en haute mer de mettre en place les mesures nécessaires, que le TIDM estime devoir être « aussi ambitieuses et efficaces que possible » et de les faire respecter auprès des acteurs non étatiques. Là encore, des obligations particulières telles que la protection et la préservation des écosystèmes rares et délicats ou la préservation des ressources biologiques marines menacées viennent renforcer l’obligation énoncée par l’article 192 de la CNUDM.
Ainsi, par cet avis consultatif, le TIDM donne une interprétation extensive des articles de la CNUDM pour rappeler aux États parties leurs obligations en matière de protection, réduction et maîtrise de la pollution du milieu marin du fait des conséquences des émissions anthropiques de GES sur le changement climatique.
Textes
Il créé les notions d’opérateur de drone maritime et de centre d’opération à distance et son titre Ier ajoute au sein du code des transports un régime sui generis complet applicable aux drones maritimes dont il définit les conditions d’exploitation ainsi que les caractéristiques techniques. Ces dernières ont fait l’objet d’une notification à la Commission européenne au titre de la directive n°2015/1535 du 9 septembre 2015 relative aux réglementations techniques.
Le titre II relatif aux navires et navires autonomes adapte, quant à lui, aux navires autonomes les dispositions du décret n°84-810 du 30 août 1984, du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 et du code des transports. Il modifie également certaines procédures du décret n°84-810 du 30 août 1984 en matière de prorogation des titres de sécurité maritime, de recouvrement et de conditions d’embarquement de passagers sur des navires de pêche lors des évènements nautiques, dits "fêtes de la mer".
Le décret n° 2024-506 clarifie ainsi la procédure de transfert des contrats de travail des salariés de l’établissement public industriel et commercial de la RATP, en cas de changement d’exploitant d’un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France. Il détermine également la procédure applicable à la fixation du nombre d’équivalents en emplois à temps plein à transférer ainsi que les modalités de transfert des contrats de travail des salariés, en fonction des catégories d’emplois et de l’exercice des missions en centre-bus ou en entité mutualisée. Il précise enfin la procédure d’information et d’accompagnement des salariés et de leurs représentants.
Ce texte est accompagné de deux autres décrets précisant, d’une part, les conditions d’entrée en vigueur des règles spécifiques de temps de travail et de repos applicables aux conducteurs de bus dont le parcours est majoritairement effectué dans la zone dense urbaine francilienne et, d’autre part, les fonctions des entités mutualisées exclues du champ du transfert.
L'actualité des réseaux
Figuraient notamment à l’ordre du jour une présentation du rôle et de la place des juristes au sein des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN) et une présentation sur le droit des dérogations à l’interdiction des atteintes aux espèces protégées. Ces réunions ont également permis à la direction des affaires juridiques de réaliser une présentation de l’application « Partaj », qui permet notamment aux juristes en services déconcentrés de soumettre une question à la DAJ, sous réserve d’avoir préalablement saisi la direction métier compétente.
Une réunion du réseau Juridique de l’Ouest (RJO) a également eu lieu le 18 juin 2024.
Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, sur le cadre général du régime de réparation du préjudice écologique ainsi que sur les actions du réseau juridique de l’Ouest, avec notamment un point d’avancement des travaux du groupe de travail « contrôle de légalité des documents d’urbanisme », qui a pour but d’harmoniser la position de l’État, notamment quant aux arguments susceptibles d’être avancés dans le cadre des déférés préfectoraux. Enfin, la DAJ a pu faire une présentation de l’outil « Partaj » mais également du prochain déploiement de l’outil « Litij » destiné à la gestion des dossiers contentieux, et de ses principales fonctionnalités.
Les contraventions de voirie routière concernées sont énumérées à l’article R. 116-2 du CVR.
Outre la réparation de l’atteinte au domaine public, ce dispositif fait peser la charge des frais annexes (balisage, nettoyage…) sur l’individu responsable du fait du dégât. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 1994 (Burckard c/ COFIROUTE, n° 92-19768) a d’ailleurs confirmé le principe de réparation intégrale du préjudice en cas de dégât au domaine public routier (les frais annexes étant, dans le cas d’espèce, un balisage et la protection des lieux).
Par exemple, constitue un dégât au domaine public le déversement d’hydrocarbures ou la perte d’huile sur la chaussée. Aussi, les actions de pompage (absorbants) et de nettoyage qui en découlent, font partie des mesures connexes au dégât dont le remboursement doit être demandé à l’usager fautif.
Cependant, en cas d’accident de la circulation sans dégât au domaine public routier, les coûts engendrés par l’accident ne peuvent pas être mis à la charge de l’usager.
En principe, les interventions hors contraventions de voirie routière ne peuvent pas être facturées, car cela s’apparente à une redevance pour service rendu, définie comme une redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé et qui doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service (CE Ass., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens ; CE Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital).
Les redevances sont instituées par décret en Conseil d’État. Il n’existe aucun décret ayant institué une redevance pour les interventions des DIR hors contraventions de voirie routière.
De plus, une redevance ne peut être instituée que pour les prestations excédant les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir gratuitement (CE, 28 décembre 1949, Société ciné Lorraine).
En d’autres termes, une redevance ne peut être créée que pour financer des prestations qui vont au-delà des missions de service public du service concerné. Or les interventions des DIR hors contraventions de voirie routière visent à assurer la sécurité des usagers de la route ; et de ce fait relèvent des missions normales de la DIR.
Par exception, le seul texte qui permet aux DIR de facturer à des tiers des prestations pour service rendu est l’article 1er du décret n°2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé des transports. Il énumère les prestations qui peuvent être facturées (et à qui) par les services du ministère chargé des transports. Peuvent notamment être facturées à des personnes publiques autres que l’État, ou à des personnes privées, les prestations qui prennent la forme de travaux d’entretien et d’exploitation d’infrastructures de transports (article 1, 7° du même décret).
Les interventions sur accidents ne figurent pas dans la liste des prestations que ce décret permet de facturer à des tiers.
En dehors des contraventions de voirie routière, et sauf exécution de travaux d’entretien et d’exploitation d’infrastructures de transports, la facturation aux usagers des frais d’intervention des DIR n’a pas de base légale.
3 questions à … ,
Cécile Avezard, directrice générale de Voies navigables de France (VNF)

Le recours au fluvial dans la construction du Village des Athlètes a ainsi facilité la réalisation des chantiers, particulièrement complexes pour la filière bâtiment, en permettant :
- d’évacuer plus de 500 000 tonnes de déblais pour les terrassements des chantiers du site et le creusement d’une galerie souterraine entre Saint-Denis et Villeneuve-la-Garenne pour l’enfouissement des lignes à haute tension ;
- d’amener les matériaux nécessaires à la construction du Village des Athlètes (façades, ossatures-bois, caissons préfabriqués en bois, second-œuvre, etc.) et des ouvrages connexes comme le franchissement au-dessus de la Seine qui reliera L’Île-Saint-Denis à Saint-Denis ;
- d’éviter la circulation de 25 000 camions sur les routes durant le chantier.
Durant l’évènement, la navigation est réorganisée pour faire cohabiter cet évènement inédit qui mobilise fortement la Seine (parade d’ouverture, épreuves de nage, accès et sécurisation du village olympique) et le maintien des activités économiques.
Alors que le bras principal de la Seine à Saint-Denis a été mis à disposition de Paris 2024 pour sécuriser le Village des Athlètes, VNF a assuré, pour le compte de la SOLIDEO, la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement du bras secondaire de Gennevilliers, afin de permettre la continuité de la navigation à grand gabarit cet été.
L’aménagement de cet ouvrage olympique, qui a bénéficié d’un investissement de 15 millions d’euros de la SOLIDEO, permettra d’assurer le transport de 2 millions de tonnes de marchandises pendant toute la durée des Jeux – soit l’équivalent de 100 000 camions – malgré la fermeture du bras principal, qui rouvrira le 12 septembre.
Le bras secondaire de Gennevilliers constitue par ailleurs un héritage, dont l’usage se poursuivra après les événements olympiques.
La réalisation du nouvel ouvrage a été confiée à une société dédiée : la Société du Canal Seine Nord Europe. Cet établissement public local est en charge de la maitrise d’ouvrage du canal. Les collectivités locales sont à la tête du conseil de surveillance de la société qui agit en partenariat étroit avec l’État et l’Europe.
Cet ouvrage sera ensuite exploité par VNF, dans la continuité du linéaire existant et sur le territoire national.
Le Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE) Seine-Escaut coordonne l’ensemble des opérations qui se déroulent en France et en Belgique et qui réunit : Voies navigables de France (VNF), l’opérateur flamand De Vlaamse Waterweg nv (DVW), l’opérateur wallon qu’est le Service public de Wallonie (SPW) ainsi que la Société du Canal Seine-Nord Europe, SCSNE.
D’ici fin 2030, 1 100 km de voies fluviales à grand gabarit seront mis en réseau, traversant six régions européennes et reliant 50 ports maritimes, 90 ports de plaisance, 60 ports intérieurs et 360 communes.
Le réseau Seine-Escaut est prévu par une Décision d’Exécution adoptée par la Commission européenne le 27 juin 2019. Cette dernière a défini les engagements des acteurs impliqués, les objectifs et un calendrier d’action.
Le réseau Seine-Escaut représente un investissement de 10 milliards d’euros sur la période 2007-2030, dont la moitié pour la construction du nouveau canal Seine Nord Europe. Projet prioritaire pour la politique des transports en Europe, le réseau Seine-Escaut bénéficie depuis 2004 d’un important financement de l’Union Européenne.
Le financement du réseau Seine-Escaut est aussi national et local. En France, l’État, l’AFIT (Agence de financement des infrastructures de transport de France), les régions Hauts-de-France, Île-de-France, Grand-Est et Normandie, ainsi que les départements, les intercommunalités et les agences de l’eau, financent le réseau. En Belgique, les financements émanent des régions de la Flandre et de la Wallonie.
VNF intervient sur différents pans du projet. Il assure le pilotage et le secrétariat du GEIE, qui coordonne les financements et le suivi opérationnel des acteurs.
VNF est également maitre d’ouvrage de travaux de régénération et de modernisation du réseau qui est en continuité du nouvel ouvrage :
- Études des projets de mise au gabarit européen de l’Oise (Mageo) et de la Seine entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine amont ;
- Travaux de modernisation des écluses de Méricourt sur la Seine ;
- Travaux sur l’axe Deûle-Lys (recalibrage de la Deûle, allongement de l’écluse de Quesnoy et dragage de la lys mitoyenne) ;
- Remise en navigation du canal de Condé-Pommeroeul ;
- Doublement de l’écluse de Fontinettes.
D’une manière générale, ce projet d‘envergure européenne est un levier pour régénérer, moderniser ou mettre au gabarit les principaux ouvrages de la Seine connectée au port du Havre et du réseau navigable connecté au port de Dunkerque.
La concertation prend la forme d’un débat public sous l’égide d’une personnalité indépendante désignée par la Commission nationale du débat public. Celle-ci veille à la qualité et à la sincérité des informations diffusées, et favorise l’expression de l’ensemble des publics (riverains, usagers de la voie d’eau, élus, acteurs économiques, associations…).
À titre d’exemple, sur le projet de Mise au Grand Gabarit de l’Oise, le dialogue a été continu. MAGEO est un projet à l’historique ancien, qui a émergé dans les années 1970. Il a fait pour la première fois l’objet d’une consultation élargie du territoire des acteurs avec une cinquantaine de réunions entre octobre 1997 et mai 1998, qui a donné lieu à des évolutions du projet et des études complémentaires pour tenir compte des remontées. En 2011, la Commission nationale du débat public (CNDP) a préconisé l’organisation d’une concertation qui s’est déroulée en 2012 sous l’égide d’un garant, personnalité indépendante, nommé par la CNDP. La concertation s’est traduite par 29 engagements de la maîtrise d’ouvrage, sur le volet environnemental, hydraulique, en matière de navigation, de déroulement des travaux et de partage. Tout au long des procédures et notamment en amont de l’enquête publique préalable à la DUP, plusieurs réunions d’informations et d’échanges ont été organisés. L’enquête publique DUP s’est tenue en 2021 et l’arrêté de DUP a été pris le 22 avril 2022.
N°4 du 16 juillet 2024 - Angle droit 27
Comité éditorial : Olivier Fuchs, Umberto Berkani, Lucie Antonetti, Amandine Berrruer, Ninon Boulanger, Soizic Dejou, Sophie Geay, Stéphanie Grossier, Méhar Iqbal, Sabrina Lalaoui, Nadia Lyazid, Olivier Meslin, Sophie Namer, Emma Quarante, Clémence Roul, Louise Soulard, Licia Villotta, Isabelle Volette, Pascal Zabal
Pour vous abonner ou vous désabonner à cette e-lettre, merci de fournir ci-après votre adresse de messagerie. Tous les champs marqués d’une astérisque (*) sont obligatoires.